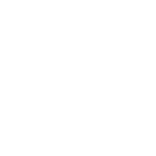En droit fiscal canadien et québécois, les administrateurs de sociétés occupent une position stratégique qui les expose à des responsabilités personnelles importantes. Parmi celles-ci, la responsabilité liée aux retenues à la source et aux taxes à la consommation (TPS/TVQ) est particulièrement rigoureuse. Cette responsabilité vise à assurer que les sommes perçues ou retenues par la société au nom des autorités fiscales soient effectivement remises à ces dernières. Le présent texte explore les fondements juridiques de cette responsabilité, les mécanismes de défense disponibles, ainsi que les implications pratiques pour les administrateurs.
À noter également que les administrateurs peuvent être également tenus à certaines dettes fiscales dans le cas où la société décide de liquider l’ensemble de ses actifs alors qu’elle a des dettes fiscales. Des formulaires sont à produire avant de procéder à la liquidation et un oubli pourrait coûter très cher.
Nous reviendrons dans un prochain texte sur les obligations de produire différents formulaires de renseignements auprès des autorités fiscales.
Les montants appartenant aux autorités fiscales et l’obligation de les remettre
Les retenues à la source comprennent notamment l’impôt sur le revenu prélevé sur les salaires, les cotisations au RPC ou au RRQ, ainsi que les cotisations à l’assurance-emploi. Ces sommes sont réputées être détenues en fiducie pour le bénéfice du gouvernement. C’est pour cette raison que l’on mentionne que ces sommes « appartiennent » d’entrée de jeu aux autorités fiscales.
En vertu de l’article 227.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu (« LIR ») et de l’article 24.0.1 de la Loi sur l’administration fiscale (« LAF »), les administrateurs peuvent être tenus solidairement responsables avec la société pour le paiement de ces montants.
Les taxes à la consommation, telles que la TPS et la TVQ, sont également perçues pour le compte des autorités fiscales. Le défaut de remise peut entraîner une responsabilité personnelle des administrateurs.
Cette obligation demeure très sévère et il est très difficile de s’y soustraire. Alors que pour qu’un administrateur soit tenu responsable personnellement des montants mentionnés plus haut, les conditions suivantes doivent être réunies :
- la société a omis de percevoir ou de remettre les sommes exigées (DAS, RAS, TPS et TVQ);
- l’impossibilité de recouvrement par les autorités fiscales;
- et le statut de l’administrateur (celui inscrit aux Registres et celui qui n’est pas inscrit mais qui agit comme tel : l’administrateur de facto).
À noter que les autorités fiscales doivent d’abord identifier une dette valide (par un avis de cotisation) et obtenir un jugement ex parte statuant qu’elles peuvent entreprendre des mesures de recouvrement pour un montant déterminé. Par la suite, ces mesures de recouvrement, comme des saisies directes ou en mains tierces, seront exécutées. S’il demeure un solde, les autorités fiscales se retourneront vers l’administrateur. La responsabilité des administrateurs demeure également dans le cas où la société ferait faillite et qu’elle aurait toujours des dettes en matière de retenues à la source et de TPS-TVQ.
Les moyens de défense
Un administrateur peut se dégager de sa responsabilité s’il démontre qu’il a agi avec prudence, diligence et compétence raisonnables. Cette défense repose sur une analyse objective du comportement de l’administrateur dans le contexte de la société. Les administrateurs internes sont censés être plus informés, tandis que les externes doivent rester vigilants.
En utilisant ce type de défense, il est important de démontrer les mécanismes en place au sein de la société faisant en sorte que cette dernière faisait tout ce qui était possible pour respecter ses obligations en matière de remise de taxes et de retenues à la source. On cite souvent à titre d’exemple le fait de produire ses déclarations à jour, utiliser un compte bancaire destiné uniquement aux remises fiscales, éviter d’utiliser les sommes visées par les remises à titre de fonds de roulement de l’entreprise et toute autre méthode permettant de protéger ces montants de remise.
Finalement, les dispositions de la loi prévoient dans le cas des remises aux autorités fiscales une prescription de deux ans : un administrateur ne peut être tenu responsable personnellement des sommes dues auprès des autorités fiscales si plus de deux ans se sont écoulés depuis qu’il a quitté ses fonctions.
Encore une fois, la jurisprudence est volumineuse sur le degré de preuve requis pour déterminer le moment où l’administrateur a quitté ses fonctions. De façon générale, il faudra être en mesure de démontrer qu’une démission a été remise dans les délais contemporains avec la date inscrite sur la lettre de démission et que la société l’a effectivement reçue. Si la société a accusé réception de cette lettre et a modifié les registres adéquats de façon contemporaine, cela constitue une preuve solide opposable aux tiers, comme les autorités fiscales. L’important est donc de documenter le plus possible le départ d’un administrateur.
La responsabilité fiscale des administrateurs lors de la liquidation d’une société
La liquidation d’une société, qu’elle soit volontaire ou forcée, entraîne une série d’obligations légales et fiscales. La responsabilité fiscale d’un administrateur peut être engagée dans ces circonstances.
Ainsi, lorsqu’une société entre en liquidation, elle demeure assujettie aux obligations fiscales habituelles jusqu’à sa dissolution complète. Cela inclut :
- la production des déclarations fiscales (impôt sur le revenu, taxes de vente, retenues à la source, etc.);
- le paiement des soldes dus à l’Agence du revenu du Canada (ARC) et à Revenu Québec;
- la remise des documents requis, tels que les relevés fiscaux pour les employés.
Le liquidateur de la société, souvent nommé parmi les administrateurs ou désigné par eux, est alors responsable de s’assurer que ces obligations sont respectées.
L’article 14 LAF (art. 159 LIR) impose une obligation préalable à toute distribution de biens appartenant à une société d’obtenir un certificat du ministre attestant qu’aucun montant n’est exigible à l’égard de cette personne.
Qui a cette responsabilité? Les administrateurs de la société et le liquidateur.
Si un administrateur procède à la distribution sans avoir obtenu le certificat, il devient personnellement responsable des dettes fiscales de la société, jusqu’à concurrence de la valeur des biens distribués. Le certificat se demande par voie de formulaire. Cette responsabilité est automatique et ne dépend pas de la diligence ou de la bonne foi de l’administrateur. Contrairement aux dispositions mentionnées en lien avec les remises, aucune défense fondée sur la diligence raisonnable ou le délai de deux ans n’est applicable dans ce cas.
La responsabilité peut être engagée jusqu’à 12 mois après la distribution des biens ou après que les autorités fiscales en ont été informées.
Les bonnes pratiques à adopter
Les administrateurs doivent s’informer régulièrement de la situation fiscale de la société, s’assurer que les déclarations fiscales sont produites à temps, vérifier que les paiements fiscaux sont effectués dans les délais requis ou que des ententes sont prises pour le paiement des obligations fiscales, documenter les décisions et les actions prises pour respecter les obligations fiscales, mettre en place des mécanismes de contrôle, consulter des fiscalistes ou des professionnels compétents et envisager la démission en cas de risque.
Une assurance responsabilité peut également offrir une protection.
La charge des administrateurs est certes lourde et il est donc important d’être bien informés. À noter également que les responsabilités s’appliquent autant aux sociétés qu’aux sociétés opérant sous forme d’organisme sans but lucratif.
Que faire en cas de cotisation par les autorités fiscales?
Lorsqu’un administrateur d’une société par actions reçoit un avis de cotisation à titre de responsabilité d’administrateur pour des montants non remis (tels que les retenues à la source ou la TPS/TVQ), il dispose de certains recours prévus par les dispositions législatives autant au provincial qu’au fédéral.
D’une part, un administrateur qui reçoit un avis de cotisation peut notamment la contester en produisant un avis d’opposition, disposant d’un délai de 90 jours à compter de la date de l’avis de cotisation (art. 93 LAF ou art. 165 LIR). L’opposition permet à l’administrateur de contester la validité ou le montant de la cotisation.
D’autre part, un administrateur a également la possibilité de demander aux autorités fiscales un allègement pour les pénalités et intérêts figurant dans un avis de cotisation, soit par une annulation, une réduction ou une renonciation de ceux-ci (art. 94.1 LAF ou art. 220(3.1)LIR), en démontrant qu’il a agi avec la diligence requise ou qu’il existe des circonstances exceptionnelles justifiant un tel allègement.